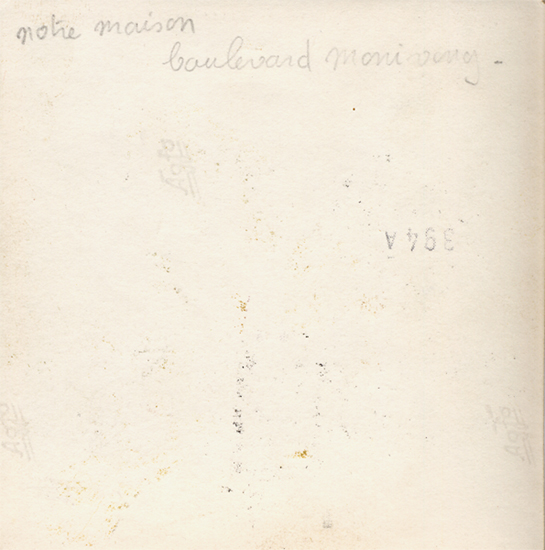photographie (120x120cm), livrets (texte en français et en khmère), 2005.
Exposition collective « Air Cambodia », Centre Culturel Français (Phnom Penh, Cambodge) et Palais de Tokyo (Paris), 2005.
Ma famille a vécu à Phnom Penh en 1971. Militaire français de carrière, mon grand-père avait été envoyé au Cambodge pour conseiller l’armée khmère. Il était instructeur. Sa famille l’a suivi.
Ils sont arrivés en décembre. Huit mois plus tard, femmes et enfants étaient rapatriés d’urgence ; les Khmers Rouges assiégeaient la ville.
Mon grand-père, lui, est resté un peu plus longtemps.
Leur maison se trouvait sur le boulevard Monivong entre la cathédrale et l’hôpital Calmette. C’était un bâtiment de type colonial, sur deux niveaux, avec une partie sur pilotis et un balcon tout le long du premier étage. Un grand jardin entourait la maison et faisait angle avec un petit chemin de terre. Ils étaient proches de l’ambassade de France, juste en face de celle de Russie.
Ma mère, mon oncle et ma tante allaient à pied au lycée français Descartes.
Depuis que je suis petite, ma grand-mère me parle de ses souvenirs du Cambodge, du magnifique flamboyant de leur jardin. Et de Cannelle qui la suivait partout, une petite cane devenue son animal de compagnie.
Quand ma famille est partie, ma grand-mère a confié l’animal à des voisins, leur demandant d’en prendre soin. Au fond d’elle-même, elle sait très bien qu’il a été cuisiné. Depuis, elle ne mange plus de canard.
Ma mère a des souvenirs très vifs de cette époque.
Elle n’a pas oublié sa Tiba, la dame qui s’occupait d’elle. Un jour lors d’une bataille de rue, elles s’étaient réfugiées toutes les deux sous une voiture. Persuadée qu’elle allait mourir, la Tiba, qui était très croyante, ne pouvait pas se retrouver devant Bouddha le ventre vide. Malgré le danger, elle voulait à tout prix aller au marché pour acheter des oeufs de cane. Il fallait une offrande.
Lors des bombardements sur l’aéroport, sa chambre sur pilotis tremblait.
A chaque alerte, tous les français se retrouvaient au Cercle, un bâtiment militaire où ils se réfugiaient.
Elle m’a aussi raconté l’histoire de ce pasteur français que ma famille connaissait bien, retrouvé un jour assassiné, les testicules coupés et mis dans la bouche.
Elle se souvient aussi des odeurs de la terre, des épices, de la viande.
Les seuls souvenirs que m’a laissés mon grand-père sont ambigus.
J’étais petite.
Il me racontait à mots couverts ses rapports avec les femmes.
J’ai compris plus tard ses allusions, sa perversité et ses histoires.
Ses attouchements. J’ai pu en discuter avec ma mère, ma tante. Et longtemps après avec ma grand-mère.
Je n’ai pas été la seule.
J’ai l’impression de retrouver cette ambiguïté ici. La situation de l’homme blanc, ce qu’il représente pour toutes ces jeunes femmes qui ont eu le malheur de perdre leur virginité avant le mariage. Exclues de la société cambodgienne, leur seul devenir est la prostitution. Jeunes et jolies, encore fraîches, souriantes et avenantes, les occidentaux ont moins de remord à les côtoyer.
Juste avant de partir au Cambodge, j’ai recherché les vieilles photos de cette époque. Je n’en ai trouvé qu’une, en noir et blanc, prise par ma mère.
Ecrit au dos : « Notre maison, boulevard Monivong ».
Il fallait que je retrouve cette maison, comme pour comprendre ce qui s’était passé.
Ma mère avait à peu près mon âge. Je me retrouve ici, trente ans plus tard, par hasard.
Sitôt arrivée, j’ai demandé à un taxi local, un moto-dop, de m’emmener sur le boulevard Monivong. Je lui ai montré ma photo. Nous avons cherché ensemble. L’hôpital Calmette était bien là, mais aucune trace de la cathédrale.
Le moto-dop me comprenait mal. Nous avons tourné très longtemps.
Nous avons fini par trouver une barrière semblable à celle de la photo, mais la maison n’était pas vraiment la même.
Le lendemain, j’ai rencontré Dou Borin, un Cambodgien qui travaille pour le Centre Culturel Français. Quand je lui ai montré la photo, ses yeux se sont illuminés. Cette quête lui plaisait, il était décidé à m’aider.
Son premier geste a été d’en tirer un agrandissement et de la faire circuler parmi tous les Cambodgiens assez âgés pour avoir connu la ville à l’époque.
En recoupant les informations recueillies, nous sommes arrivés sur la piste d’un orphelinat, peut-être construit sur le terrain. La maison, elle, aurait été rasée.
Borin m’a aussi expliqué que la cathédrale n’existait plus, détruite par les Khmers rouges en 1976. Il n’en reste que quelques débris de cloches exposés au musée national. Une immense antenne russe a pris la place.
J’essayais de comprendre pourquoi ils avaient fait ça, lui parlant également de l’histoire du pasteur émasculé. Il m’a répondu que toutes les religions avaient été interdites, surtout celles qui venaient d’Occident, et qu’ils avaient été très cruels, tuant même les animaux.
Pour lui, ça voulait tout dire.
Grâce à ses traductions, je pu parler aux habitants de cette maison semblable à la photo. Après une longue discussion, la piste de l’orphelinat s’est révélée fausse et nous avons été dirigés vers une maison entièrement rénovée. Mise au goût du jour, et collée à un hôtel moderne. Je n’y croyais pas beaucoup.
Par chance, nous avons croisé le propriétaire à qui nous avons raconté l’histoire et montré la photo. Il m’a regardé avec un grand sourire et m’a avoué en français s’être installé dans cette maison à son retour à Phnom Penh en 1979. Il me propose de revenir un peu plus tard pour rencontrer sa femme qui me donnera certainement plus d’informations.
Et qui peut être retrouvera de vieilles photos.
Mais l’accueil ne fut pas le même. Après un temps d’hésitation, elle contredit toutes les affirmations de son mari. Toutes les excuses étaient bonnes pour que ça ne soit pas la maison recherchée. La clôture n’était pas comme ça, le balcon n’existait pas, son mari avait de mauvais yeux.
J’avais l’impression d’être retombée dans une impasse.
Sur le chemin du retour, Borin m’a fait part de ses doutes concernant la sincérité de cette femme. Il pensait qu’elle avait peur que je veuille lui reprendre la maison. La photo constituant à ses yeux une preuve suffisante.
En 1975, quand les Khmers rouges ont pris possession de la ville, ils l’ont entièrement vidée de ses habitants, et les ont envoyés au travail forcé dans les campagnes. Phnom Penh était devenue une ville fantôme.
A la libération, les survivants qui sont revenus se sont installés dans les maisons vides.
J’y suis retournée plusieurs fois, pour tenter de leur expliquer que ça n’était pas du tout mon intention. Mais je n’ai pas pu les revoir.
Par la suite, j’ai rencontré l’ancien sacristain de la cathédrale détruite qui m’a raconté son histoire et comment il avait survécu aux khmers rouges. _ D’un père cambodgien et d’une mère vietnamienne, il avait été rapatrié au Vietnam avec sa femme et ses enfants, après être passé par des travaux forcés à la rizière.
A ce moment, les Khmers rouges étaient encore les alliés des Vietcong, et le sacristain avait bénéficié du « premier voyage ». Un an plus tard, les Vietcong ont lâché les Khmers rouges et la Chine pour s’allier à la russie.
Cette année là, tous les Vietnamiens encore au Cambodge ont été assassinés. Parmi eux, ses parents, oncles et tantes.
Il n’y a jamais eu de second voyage.
Après la période des khmers rouges, il est revenu au Cambodge comme coiffeur, afin de voyager librement dans le pays. Secrètement, il a listé toutes les familles catholiques pour, un jour, reconstituer une communauté religieuse. Il entretenait aussi une correspondance discrète avec les prêtres survivants. La première messe officielle eu lieu le 14 avril 1990.
Nous sommes tous les deux retournés devant la maison et il m’a confirmé ce que m’avait dit Borin. La propriétaire avait eu peur. Mais cette maison est probablement celle dans laquelle ma famille a vécu.
Toutes les descriptions correspondent et la première rencontre avec son propriétaire avait été sincère.
Peu importe. A ce stade de mon voyage, mes préoccupations n’étaient plus les mêmes. Cette quête m’avait rapprochée des Cambodgiens, permis de comprendre leur histoire douloureuse et ce que m’a famille m’avait raconté.
Sans cette photo, rien de cela ne se serait passé.
Grâce à cette complicité, à cette recherche qui nous était devenue commune, un lien presque amical s’est tissé entre Borin et moi. Il m’a confié plus tard son histoire personnelle. Il n’avait que douze ans quand sa famille a été séparée et lui, envoyé au travail forcé dans les campagnes. A son retour, toute sa famille avait été assassinée, onze personnes massacrées. Orphelin, il a dû pour survivre se nourrir d’écorces d’arbre et d’embryons de souris. Il a marché pendant trois mois avant de retrouver une de ses tantes.
Ce qu’il lui en reste aujourd’hui : un goût amer.
Phnom Penh,
janvier 2005.